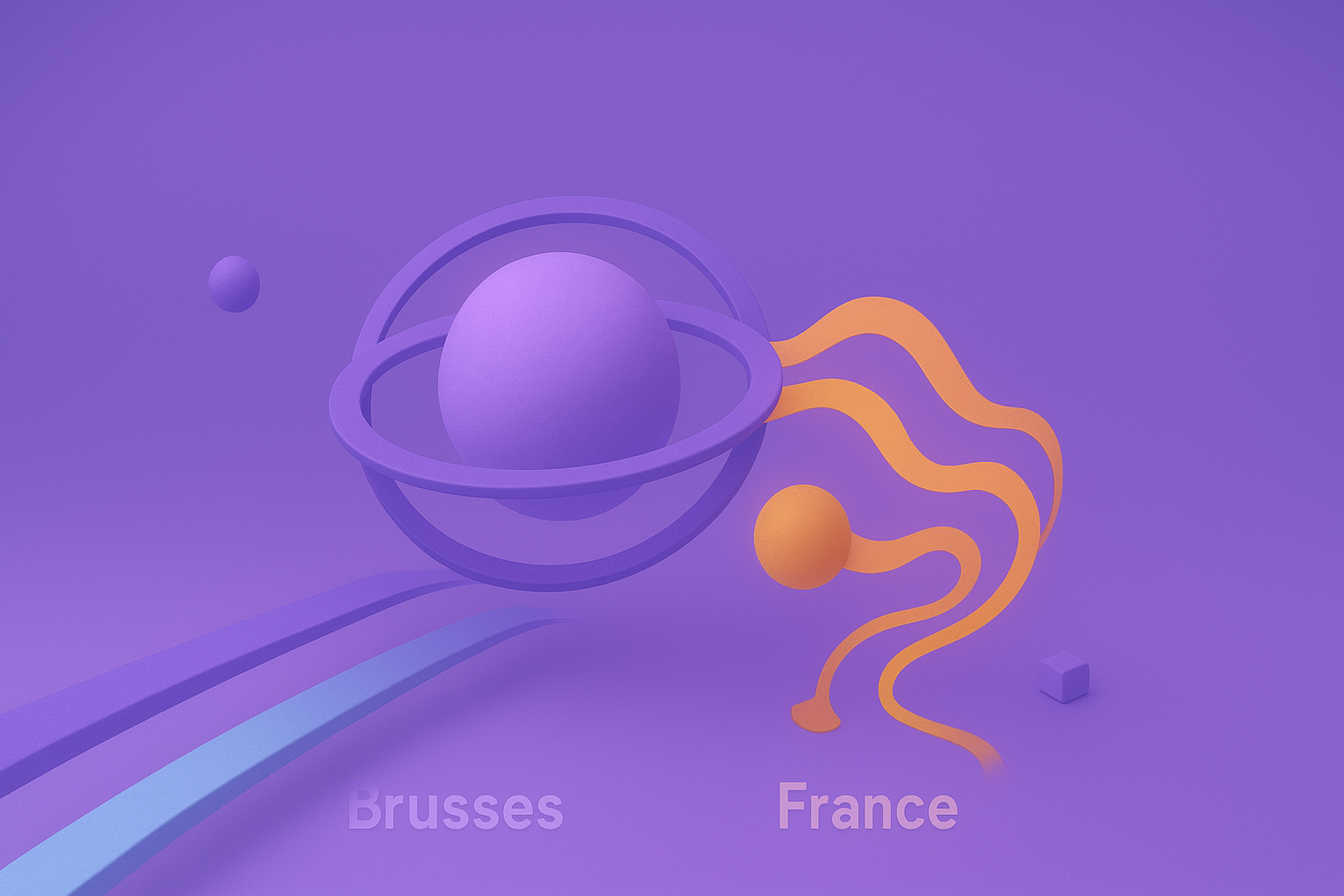L’Union européenne, à travers l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), souhaite renforcer la supervision des actifs numériques par une centralisation accrue. Toutefois, la France s’oppose fermement à ce projet, soulevant des questions de souveraineté, de cohérence réglementaire et d’équité entre États membres.
Que prévoit l’AEMF ?
L’AEMF propose que la supervision des acteurs crypto ne soit plus assurée uniquement par les autorités nationales, mais qu’elle soit centralisée au niveau européen. Cette réforme aurait pour objectif d’harmoniser la régulation des actifs numériques, d’éviter les divergences entre pays et de simplifier les procédures d’autorisation pour les entreprises opérant dans plusieurs États de l’Union.
Actuellement, chaque pays européen délivre ses propres licences crypto, entraînant une multiplication des démarches et des standards parfois très différents. Ce système crée une forme de concurrence réglementaire qui nuit à la stabilité du marché. En centralisant la régulation, Bruxelles espère renforcer la transparence, la sécurité des investisseurs et la crédibilité de l’écosystème européen.
Pourquoi la France résiste
La France redoute plusieurs effets négatifs d’une telle centralisation. D’abord, elle y voit une atteinte à sa souveraineté réglementaire, estimant que ses autorités, comme l’Autorité des marchés financiers (AMF), doivent conserver un rôle central dans la surveillance des acteurs opérant sur son territoire.
Ensuite, Paris craint une perte de contrôle sur le processus d’agrément et de supervision, au profit d’une institution européenne potentiellement éloignée des réalités du marché local.
Enfin, la question du passporting — qui permet à une entreprise agréée dans un pays de l’UE d’exercer dans tous les autres sans nouvelle autorisation — demeure sensible. La France souhaite éviter qu’une société obtienne une licence dans un État à la régulation plus souple pour ensuite proposer librement ses services en France, sans contrôle direct.
Enjeux pour MiCA et le marché unique européen
Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets), en cours de déploiement, vise justement à instaurer un cadre harmonisé pour les cryptomonnaies dans toute l’Union. Cependant, sa mise en œuvre varie selon les pays, notamment sur le plan du contrôle et des exigences imposées aux plateformes. Certains États appliquent des standards plus stricts, tandis que d’autres privilégient une approche plus flexible, ce qui crée des déséquilibres et des risques d’arbitrage réglementaire.
La centralisation de la supervision sous l’autorité de l’AEMF pourrait corriger ces disparités et instaurer un niveau de contrôle commun, renforçant la confiance des investisseurs et la stabilité du marché. À l’inverse, si la résistance des États persiste, MiCA pourrait se transformer en un cadre “à deux vitesses”, limitant l’efficacité de l’intégration financière européenne.
Conséquences possibles
Si l’AEMF obtient le pouvoir de centraliser la régulation, cela pourrait conduire à une supervision plus uniforme, réduire la fragmentation du marché et renforcer la crédibilité de l’Union européenne dans le secteur des cryptomonnaies. Les investisseurs bénéficieraient d’une meilleure protection et les entreprises d’une plus grande clarté juridique. Cependant, une centralisation excessive risquerait d’affaiblir les autorités nationales, de réduire leur capacité à agir rapidement et d’alourdir la bureaucratie européenne.
À l’inverse, si la France et d’autres États membres parviennent à maintenir une supervision nationale, les différences réglementaires pourraient perdurer. Cela favoriserait une concurrence entre juridictions, parfois au détriment de la sécurité des utilisateurs et de la stabilité du marché. Dans les deux cas, la recherche d’un équilibre entre harmonisation européenne et souveraineté locale sera déterminante pour l’avenir du cadre crypto en Europe.
Conclusion
Le débat entre la France et l’Union européenne illustre les tensions croissantes entre intégration réglementaire et autonomie nationale. L’ambition de Bruxelles de centraliser la supervision vise une meilleure cohérence, mais se heurte à la volonté des États de préserver leur autorité.
Le compromis qui émergera dans les prochains mois définira non seulement l’avenir du règlement MiCA, mais aussi la place de l’Europe dans la régulation mondiale des actifs numériques.